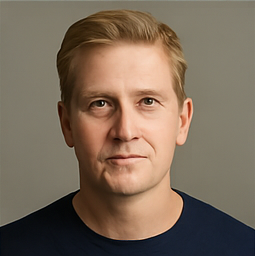Donald Trump, 100 jours à la Maison-Blanche : "L’annonce des tarifs douaniers a été un tournant"

Depuis l’investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier, il ne se passe pas un jour sans que le nouveau président des Etats-Unis signe une série d’ordonnances. Si on ne regarde que le nombre de textes ainsi adoptés, le magnat de l’immobilier semble avoir été deux fois plus prolifique que son prédécesseur à la Maison-Blanche, et cinq fois plus que lors de son premier mandat en 2017. Pour Françoise Coste, professeure d’études américaines à l’université de Toulouse - Jean Jaurès, la fin de cette période marque l’heure d’un premier bilan. Elle avertit contre la tentation de surinterpréter la portée de ces textes. Entretien. L’Express : A chaque fois qu’un nouveau président américain est élu, tout le monde scrute avec attention son action politique lors des 100 premiers jours de son mandat. D’où vient cette tradition ? Françoise Coste : Elle remonte au premier mandat de Franklin Delano Roosevelt. Lorsqu’il est investi, en 1933, les Etats-Unis sont plongés dans la Grande Dépression, une crise économique terrible et dès le début, il va se lancer dans une frénésie législative qui inaugure ce qu’on appelle le "New Deal". En un peu plus de trois mois, il va réformer le système bancaire américain, voler à la rescousse des agriculteurs et d’une partie de l’industrie… Il va aussi mettre en place les premières lois antichômage. Bref, c’est une période qui a beaucoup marqué les esprits. Aujourd’hui, on a l’impression que Roosevelt a sauvé le pays en 100 jours et donc, par comparaison, tous les observateurs de l’Amérique s’intéressent à ce que ses successeurs ont fait lors de cette période. C’est purement artificiel, cela n’a aucune valeur juridique ou politique, c’est simplement l’occasion de faire un premier bilan de l’action présidentielle. Lors de cette période, qui commence donc le jour de son investiture, le président américain dispose-t-il de plus grandes marges de manœuvre que pendant la suite de son mandat ? Sur le plan constitutionnel, le président n’a aucun pouvoir spécifique lors des 100 premiers jours. En revanche, sur le plan politico-médiatique, c’est un moment important : celui où il dispose de la plus grande légitimité pour dérouler son programme. C’est un peu ce qu’on surnomme "la lune de miel" en France. Si un leader politique souhaite être disruptif, c’est à ce moment qu’il faut le faire même si, dans les faits, aucun des successeurs de Roosevelt n’a eu un impact aussi fort sur une période aussi courte. Comment peut-on l’expliquer ? La situation économique au début des années 30 était particulièrement catastrophique : un américain sur quatre était au chômage, il n’y avait plus aucune banque d’ouverte et des enfants mourraient de faim… Aucune comparaison possible avec une crise économique plus récente. Par ailleurs, Franklin Roosevelt disposait d’une majorité très large au Congrès [NDLR : 59 % ses sièges au Sénat et 72 % à la Chambre des représentants] qui lui a permis d’agir… Et d’agir vite ! Ce n’est pas le cas de Donald Trump aujourd’hui, bien sûr. Si on regarde le nombre d’ordonnances signées, on a pourtant l’impression que Donald Trump a fait plus de choses en 100 jours que la plupart de ses prédécesseurs… Oui, mais ce n’est pas tout à fait pareil. Une ordonnance, ce n’est pas pareil qu’un texte de loi voté au Congrès. C’est beaucoup moins ambitieux qu’une loi qui serait votée au Sénat ou à la Chambre des représentants et surtout, c’est beaucoup plus facile à défaire. Un président peut supprimer l’ordonnance d’un de ces prédécesseurs en une seule signature alors que pour faire annuler une loi, il faut voter une autre loi. C’est un processus législatif beaucoup plus laborieux. D’ailleurs, depuis le début du second mandat Trump, le Congrès a adopté très peu de lois [NDLR : 5 lois en 100 jours contre 76 lois sous la première présidence Roosevelt]. Quelle est la portée juridique de ces décrets ? A l’heure actuelle, elle est difficile à évaluer avec précision. Nous nous trouvons dans un flou juridique total. La majorité des textes que Donald Trump a signée depuis son investiture relève de l’esbroufe médiatique. La seule chose qui lui importe c’est de marquer les esprits et de se mettre en scène en train de signer un papier quelconque dans le bureau Ovale. Cela lui permet d’occuper le terrain en accaparant la presse et en faisant la une des journaux. Ces décrets sont-ils réellement suivis d’effets sur le terrain ? C’est encore un peu tôt pour le dire. Peu de temps après son investiture, Donald Trump a placé le milliardaire Elon Musk à la tête d’une agence de sa création - le département de l’Efficacité gouvernementale aussi appelé "Doge" - quel bilan peut-on tirer de son action ? Là encore, ce n’est pas évident. Le Doge, ce n’est pas un ministère, ce n’est pas vraiment une agence non plus… Personne ne sait ce que c’est réellement. On a vu Elon Musk couper dans les dépenses publiques à la hache, mais est-ce que c’était légal ? Ça, ce sera à la justice américaine de trancher. Dans certains services, les fonctionnaires limogés vont peut-être devoir être réintégrés et certains programmes ne pourront pas complètement être supprimés. Tout cela est très flou, mais ce n’est pas ça qui intéresse Donald Trump. En réalité, il agit selon une stratégie médiatique, pas une stratégie législative. Les tractations sans fin au Congrès, il n’a pas le temps pour cela et d’ailleurs, cela ne l’intéresse pas. Tout ce qui lui importe, c’est la cérémonie médiatique. Parfois, on peut avoir l’impression que ces scènes très chorégraphiées, filmées à l’intérieur même du bureau Ovale ont été inaugurées avec le premier mandat du milliardaire. De quand date ce cérémonial ? C’est vrai que Donald Trump y a plus recours que les autres, mais il n’a rien inventé. C’est une scène typique de l’ère médiatique dans laquelle nous nous trouvons. Des démocrates comme Joe Biden et Barack Obama y ont beaucoup eu recours. Il existe des exemples marquants comme lorsque le Congrès a voté Obamacare en 2010 ou lorsque Joe Biden a fait l’Inflation reduction act (IRA) au début de son mandat. Ce qui a changé avec Donald Trump, c’est le rythme frénétique que le président américain impose au monde avec ces signatures. Et cette frénésie n’est pas tout à fait du goût des Américains : les premiers sondages montrent une baisse de popularité plus importante que celle de ces prédécesseurs… Clairement, le tournant a été l’annonce des nouveaux tarifs douaniers. Une fois que les promesses de Donald Trump ont eu un effet sur la Bourse et que les Américains ont commencé à voir baisser leurs placements, leurs assurances-vie, leurs fonds de pension, cela a commencé à se ressentir sur sa popularité. Le retrait du soutien public à la recherche, le renvoi des fonctionnaires, les déportations de personnes en situation régulière, le bras de fer avec Zelensky… Rien de tout ça n’avait massivement entamé le soutien des Américains. Mais quand on commence à toucher à leur portefeuille, c’est une autre histoire. D’ailleurs, attention à ne pas surinterpréter cette baisse : effectivement Donald Trump est moins populaire que Joe Biden, Barack Obama ou même George W. Bush à l’issue de ces 100 jours, mais ça n’est pas non plus un effondrement. Il n’est pas non plus tombé à 5 %.